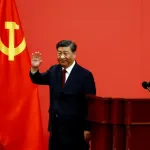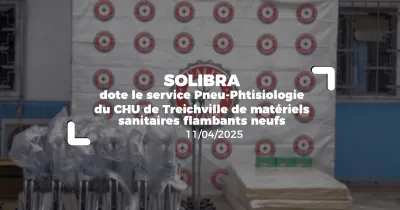Les différents membres de l’ONU ont décidé de briser les chaînes des cyberattaques répétées et ont approuvé leur premier traité de lutte contre la cybercriminalité, ce jeudi 8 août 2024.
Alors que certains trouvent cette convention « la bienvenue », d'autres y voient une arme à double tranchant qui pourrait instaurer une surveillance mondiale sans précédent. Ce qui à cet effet engendre une controverse entre les défenseurs des droits humains et les grandes entreprises technologiques, qui dénoncent un outil potentiellement dangereux pour la liberté et la vie privée des citoyens.
Une cyberdéfense internationale entamée
Après trois ans de négociations ardues, la « Convention des Nations unies contre la cybercriminalité » a vu le jour, unissant ainsi, les États membres autour d'une cause commune, celle de « combattre plus efficacement la cybercriminalité ». Ce traité, qui pourra entrer en vigueur après ratification par 40 États, aspire à renforcer la coopération internationale en matière de cybersécurité, en ciblant des crimes tels que la pédopornographie et le blanchiment d'argent.
Cette initiative ouvre la voie à une régulation mondiale des menaces qui planent sur l'univers virtuel.
Ce texte symbolise une volonté collective de faire face aux cybermenaces grandissantes, en dotant les États d'outils juridiques pour enquêter au-delà de leurs frontières. Une avancée saluée par le groupe Afrique, qui y voit une opportunité de combler le fossé technologique et de sécuriser les infrastructures numériques encore vulnérables dans de nombreux pays en développement.
La liberté numérique en péril ?
Malgré son ambition affichée, le traité fait l'objet de vives critiques. Défenseurs des droits humains et géants de la « Tech » se rejoignent pour dénoncer un périmètre jugé excessivement large, qui pourrait être détourné pour réprimer les voix dissidentes et les libertés individuelles. Le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme a exprimé des réserves sérieuses, craignant que des activités légitimes soient injustement criminalisées sous couvert de lutte contre la cybercriminalité.
Quant à la Russie, tout en soutenant le processus, a exprimé son mécontentement face à ce qu'elle perçoit comme une surabondance de garde-fous liés aux droits humains, révélant ainsi les fractures au sein de la communauté internationale sur la question des libertés fondamentales. Il faut rappeler que le chemin vers une cybersécurité universelle s'annonce semé d'embûches, où chaque pas sera scruté à la loupe par des défenseurs inquiets de voir leurs droits fondamentaux menacés. Mais, la communauté internationale devra trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les citoyens contre les cybermenaces et le respect des libertés individuelles.