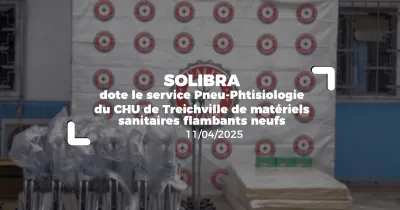Le cinéma africain s'illustre bien dans les différentes catégories au festival de Cannes 2023.
Le cinéma Africain connaît depuis quelques années un vrai dynamisme. Ça se voit sur la Croisette, notamment avec un premier film en lice pour la Palme d’or.
Sur l’un des immenses écrans du festival, entre le soleil et la terre craquelée d’un village du nord du Sénégal, Banel et Adama tentent de vivre leur amour au-delà des contraintes culturelles traditionnelles. Ils parlent en pulaar, langue parlée dans plusieurs régions d’Afrique de l’Ouest.
Ce film formellement réussi est le premier long-métrage de Ramata-Toulaye Sy, Franco-Sénégalaise de 36 ans, formée à la Fémis (école de cinéma de Paris). Et il est en course pour la Palme d’or.
Le cinéma Africain connaît depuis quelques années un vrai dynamisme
Dans la section des talents naissants, dite « Un certain regard », c’est Baloji Tshiani, cinéaste de République démocratique du Congo, qui présente Augure, un film de sorcières et de sorciers.
Au total, avec tous les films d’Afrique du Nord présents au festival, pas moins de quinze sont issus des cinquante-cinq pays du continent africain. Mais laissons de côté le Maghreb où l’histoire est encore différente et concentrons-nous sur le dynamisme du cinéma subsaharien.
Numérique et financement
Aziz Cissé, cinéaste sénégalais, place le début de cette « lame de fond au début des années 2000 avec l’arrivée de la technologie numérique ». Celle-ci a permis de tourner avec du matériel beaucoup plus léger et moins cher.
La nouvelle génération de réalisateurs a également profité d’aides à la production, « qui permettent de créer un véritable écosystème du cinéma respectant l’identité des cinéastes sans que leur nationalité disparaisse dans des productions majoritairement non africaines ». Avec souvent une dimension panafricaine très intéressante entre différents pays.
Il faut aussi citer des dispositifs d’accompagnement comme La Fabrique cinéma de l’Institut français qui, depuis quinze ans, aide des projets de films. Ceux-ci sont tout autant des fictions, des documentaires, des films d’animation… Ils bénéficient d’un réseau de salles de plus en plus dense.
Par exemple, poursuit Aziz Cissé, il y a dix ans, au Sénégal, nous avions moins de cinq salles. Il y en a désormais quatorze à Dakar, même si elles sont essentiellement dans des quartiers huppés. » Et que les jeunes restent plus accros aux Black Panther et autres blockbusters américains qu’aux films d’auteur africains.
La présence des femmes
Une situation qui évoluera avec des films en langues locales et de jeunes cinéastes qui se mettent à faire des films plus commerciaux. « On ne s’est pas encore complètement détachés de figure comme Sembène Ousmane et de l’idée qu’un bon film est un film qui dénonce. »
Autre dimension passionnante de ce dynamisme : la présence des femmes. Alors qu’il n’y avait que quelques individualités comme Safi Faye, il y a aujourd’hui une montée en puissance des réalisatrices.